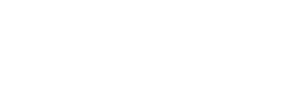Louis Schweitzer : "En Europe, le problème est cette absence de politique industrielle et commerciale commune"

Le Journal de l’Automobile : Le Dieselgate a bouleversé le regard de la société, des politiques et des lobbyistes sur l’industrie automobile. Pensez‑vous qu’il soit à l’origine de la transition énergétique que le secteur vit aujourd’hui ?
Louis Schweitzer : Je ne suis pas sûr que le Dieselgate, qui était une fraude évidente, ait eu une implication aussi grande. Cela a suscité beaucoup d’émotion. Cela a accéléré les choses et a contribué sans doute à nourrir un sentiment qui existait déjà avant, c’est‑à‑dire une méfiance vis‑à‑vis des grandes entreprises qui sont vues comme cherchant leur intérêt plutôt que celui du public. Le Dieselgate était un sujet de pollution locale qui a servi à durcir les conditions d’analyse des tests qui, disons‑le, étaient optimisés. Cette affaire a été vécue violemment. Mais au regard de l’histoire, les normes de pollution sont sévérisées de manière continue, à juste titre d’ailleurs. Nous en sommes aujourd’hui à regarder les émissions des freins et des pneus. Et si l’on observe la dernière norme Euro 7, l’industrie automobile a réussi à se faire entendre en soulignant que ce durcissement des normes de pollution des moteurs avait un coût disproportionné par rapport à son avantage, alors que le véhicule électrique arrive. Mais la vraie difficulté de l’automobile, c’est l’impact qu’elle a sur le climat. Et il serait apparu avec la même force, Dieselgate ou pas.
J.A. : Existait‑il d’autres solutions selon vous que l’interdiction des véhicules thermiques en 2035 ?
L.S. : On aurait pu imaginer une solution à l’américaine, c’est‑à‑dire de fixer une baisse des CAFE (Corporate Average Fuel Economy) qui oblige à faire des voitures moins lourdes, hybrides et une proportion croissante de modèles 100 % électriques. C’est une approche tout à fait défendable, mais je ne crois pas que les constructeurs automobiles l’aient vraiment plaidée à l’époque. La difficulté de cette échéance de 2035 se trouve du côté des services techniques et ingénieries des constructeurs, où l’on aimerait avoir un avenir certain. Or, l’ACEA s’attache à reculer cette date de 2035. Nous sommes donc dans une contradiction entre l’avantage d’un recul de la norme et le fait que pour 2035, dans onze ans, ce serait bien d’avoir un horizon certain pour l’ingénierie et la planification stratégique. De plus, la date de 2035 ne concerne que l’Europe. Si les constructeurs européens veulent survivre, ils ne peuvent pas vendre des voitures uniquement en Europe. Et donc, il y a de toute façon, pour beaucoup de pays, un avenir pour le moteur thermique qui, en termes d’efficacité et de coût, en dehors du problème climatique, est très performant.
J.A. : Quelle réaction avez‑vous lorsque Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, estime que dans cinq ans, il ne restera sans doute que cinq constructeurs automobiles dans le monde, sans citer Renault ?
L.S. : Il y a plus de 40 ans, je me souviens que Gianni Agnelli faisait le même type de prédictions à une échéance de 10 ans. Il citait quelques constructeurs qui résisteraient mais pas Renault. Mais, en même temps, il n’était pas convaincu à l’époque que Fiat survivrait, c’est pour cela qu’il avait envisagé une fusion Renault‑Fiat. Je ne sais pas le nombre de constructeurs qui survivront. Mais ce qui est frappant, c’est que je ne connais qu’un seul exemple de constructeur qui se soit créé dernièrement dans un pays ouvert à la concurrence : c’est Tesla. Dans tous les autres cas, il y a eu des disparitions, à un rythme variable, mais pas de naissances. Les naissances se sont toujours produites à l’abri de frontières protectrices.
Ce fut le cas en Allemagne pour Volkswagen, au Japon, en Corée et en Chine. Tout cela a amené des concentrations. Ce qui arrivera aussi en Chine. Mais au fond, les bons résistaient. Il n’y a pas de fatalité. Il y a des moments de crise liés à des problèmes de gestion, plus qu’à une sorte de fatalité. Et nous avons aussi vu des renaissances historiques. C’est le cas de Renault. Je ne crois pas à la fatalité, mais au risque permanent. Lorsque je suis entré chez Renault au 1er mai 1986, personne ne donnait la moindre chance au Losange. Le constructeur a été sauvé par Georges Besse et s’est ensuite développé. Nous avons prouvé qu’il n’y avait pas de fatalité. Le repli n’est jamais la réponse la plus efficiente au risque.
Le repli n’est jamais la réponse la plus efficiente au risque
J.A. : Le risque existe‑t‑il pour les constructeurs qui ne possèdent pas une taille critique ?
L.S. : Je ne suis pas sûr qu’il faille une taille minimum. La taille n’est pas une protection suffisante. L’angoisse que l’on peut avoir est que la part strictement automobile du métier de constructeur soit moins forte avec l’électrique qu’avec le thermique. De plus, avec les batteries, une part essentielle de la valeur échappe aux constructeurs. Il existe une part "d’art" dans le moteur thermique qui demande un long apprentissage. L’électrique permet d’accélérer cet apprentissage, comme l’a démontré Tesla. Mais je suis persuadé qu’il y a quelque chose d’irrationnel dans la perspective que l’on donne à Tesla. Au fond, ce constructeur est dans une situation de déséquilibre dynamique. Ou il impose la voiture autonome, que l’on voyait comme imminente il y a une dizaine d’années encore, ou il pourrait lui‑même être en situation de crise.
J.A. : Pensez‑vous que la voiture autonome va se développer ?
L.S. : Oui car c’est la seule solution dans un monde qui vieillit, dans un monde où l’accident de la route n’est plus accepté comme une fatalité et pour que des personnes âgées ou isolées bénéficient de la liberté qu’offre l’automobile. Le moment venu, la voiture autonome redonnera de la liberté pour cette génération. De même, aucun constructeur n’a la taille critique pour développer un véhicule autonome seul, sauf peut‑être Toyota.
A lire aussi : Voiture autonome : après Apple, les Gafam en retrait ?
J.A. : BYD, fabricant de batteries à l’origine, est‑il le seul aujourd’hui à maîtriser la valeur de la voiture électrique ?
L.S. : Historiquement, les grands constructeurs automobiles se basaient sur une intégration verticale totale. Tous les constructeurs automobiles ont constaté que cette intégration n’était pas une bonne solution. Aujourd’hui, je ne suis pas sûr que ce soit un avantage durable de fabriquer ses propres batteries, car on est prisonnier de ses installations. Cette technologie des batteries a été statique pendant des années. Maintenant, le rythme des changements et des innovations est impressionnant que ce soit en termes de coût, de durabilité, de puissance ou de vitesse de recharge.
J.A. : L’arrivée des constructeurs chinois, est‑elle plus dangereuse pour les acteurs européens que la concurrence des firmes japonaises, coréennes il y a quelques années ?
L.S. : À une époque, la défense des constructeurs européens était d’imposer des quotas aux véhicules japonais, de bloquer les importations coréennes… Tout cela ne marche qu’un temps. Dans le cas des constructeurs chinois, les USA peuvent faire ce qu’ils veulent mais pas les Européens. Le problème est que les Européens ne sont pas assez unis pour avoir une véritable politique commerciale et industrielle. Le risque n’est pas nécessairement lié aux Chinois. Les Coréens et les Japonais, lorsqu’ils ont conquis une part de marché en Europe, l’ont fait alors que le Japon était fermé aux importations de véhicules européens, tout comme la Corée. La situation n’est pas radicalement différente. Le problème de l’Europe est cette absence de politique industrielle et commerciale commune. C’est le fait majeur par rapport à la Chine. Ce n’est pas la Chine elle‑même, mais plutôt l’inaptitude de l’Europe dans un système mondial à être quelque chose. L’Europe est un champ de bataille et pas une puissance contrairement aux USA.
J.A. : Si la Commission européenne impose des droits de douane compensatoires, quels peuvent être les risques de mesure de rétorsion notamment sur un accès plus limité aux matières premières ?
L.S. : Je ne vois pas très bien quelle peut être la réaction des Chinois parce qu’elle ne peut pas vraiment s’appliquer sur des importations de voitures peu importantes. Les constructeurs occidentaux, qui sont installés en Chine, le sont toujours avec des JV dont la majorité est détenue par des constructeurs. Si la Chine devait réagir vis‑à‑vis d’un pays, cela se ferait d’abord par rapport aux USA. Par ailleurs, il faut également rappeler que le coût de transport d’une automobile vers l’Europe représente 1 600 euros environ. Or, le nombre total d’heures de main-d'œuvre directe et indirecte dans une usine efficiente oscille entre 15 et 20 heures. Comparé à 1 600 euros, ce n’est donc pas le bas coût de la main-d'œuvre en Chine qui fait la différence. Donc, oui, les constructeurs chinois vont installer des usines en Europe et ce seront ainsi des voitures fabriquées en Europe.
A lire aussi : Droits de douane : coup dur pour les constructeurs chinois ?
J.A. : Quel est votre sentiment après la fin de l’Alliance avec Nissan, dont vous êtes à l’origine ? Avez‑vous des regrets ?
L.S. : Oui, absolument. Mais la vérité est que l’Alliance a été tuée en 2015 quand Renault, sous la présidence de Carlos Ghosn, a signé un accord avec Nissan, dont le patron était aussi Carlos Ghosn, par lequel Renault, qui avait 44 % de Nissan, a abandonné ses droits de vote. À partir de là, c’était fini. Je n’ai jamais pensé que ce soit une bonne chose que Renault et Nissan aient le même patron. Mais je croyais qu’au moins, en ayant un seul patron, on aurait une vraie convergence des ingénieries pour avoir des plateformes et des moteurs communs… et ceci n’a pas été fait. La réalité, c’est que Carlos Ghosn, qui voulait le soutien des dirigeants japonais, n’a pas agi fermement, mais a plutôt géré cette affaire comme une fédération, sans en tirer le maximum de synergies. Seul l’univers des achats a entraîné des synergies. Mais les achats ne sont pas le cœur d’une firme automobile. C’est l’ingénierie. Dans ce domaine, entre 2005 et 2015, presque rien ne s’est passé. Mais cela se comprend pour des raisons politiques. L’ingénierie, c’est le cœur central qui est difficile à pénétrer. Et il y a eu une absence de convergence des ingénieries.
Si vous traitez les gens à l’américaine, vous finissez comme Boeing. Si vous mentez au client, il vous arrive la même chose qu’à Volkswagen et si vous traitez mal vos fournisseurs, sur le court terme, vous gagnez vite, mais sur le long terme, cela ne marche pas non plus
J.A. : Le fait que l’État français soit actionnaire de Renault a‑t‑il bloqué l’avancée du dossier ?
L.S. : Non car quand Nissan est entré dans l’Alliance avec Renault, l’État français détenait 44 % du constructeur tricolore.
J.A. : Que regrettez‑vous de votre présidence chez Renault ?
L.S. : Au fond, je n’ai pas de regrets majeurs chez Renault. Vilvorde a été une histoire douloureuse mais c’était une évidence industrielle. Cela a été une épreuve. Mais c’était la bonne décision. Après 2005, je suis resté président non exécutif de Renault. Pendant cette période, je pense avoir évité une ou deux sottises.
J.A. : Lesquelles ?
L.S. : Un projet d’Alliance où Carlos Ghosn était à la fois président de General Motors, Nissan et Renault. C’était de la folie. Le conseil d’administration en a été convaincu comme moi. Je n’étais pas fanatique du rachat de Lada, mais je n’ai pas pu l’éviter. J’ai également été désolé que Renault cède sa participation dans Volvo Trucks, malgré la forte plus‑value générée. Mon idée était de construire un grand groupe dans l’automobile et le camion. Mon regret est peut‑être d’avoir proposé le choix de Carlos Ghosn pour me succéder mais cela paraissait évident à l’époque. J’ai eu des doutes quand il a conservé la direction de Nissan, mais je n’ai jamais réussi à faire partager mes doutes jusqu’à son arrestation.
J.A. : Et votre meilleur souvenir ?
L.S. : C’est la découverte de quelques voitures. Car j’adorais le produit. Je ne suis pas ingénieur mais j’ai pris quelques décisions qui se sont avérées payantes et ce sont des souvenirs merveilleux. C’était par exemple, le Scenic pour lequel j’avais choisi de le faire en acier en non en plastique, comme l’Espace, afin d’en augmenter la production. La première fois que j’ai vu la maquette creuse grandeur nature du Scenic, j’étais heureux comme un roi, car je savais que l’on en vendrait beaucoup. Pour Dacia, les moments de bonheur les plus intenses que j’ai eus, ce sont les premières fois que j’ai conduit la Logan. Car c’était une bonne voiture. Je savais qu’elle avait les qualités requises de durabilité et de fiabilité, mais elle était aussi très agréable à conduire. J’ai aussi un autre souvenir d’euphorie : c’est lorsque l’on m’a apporté une photo de Roumains qui faisaient la queue devant une concession Dacia, comme des gens devant un cinéma.
J.A. : Pourquoi personne n'a jamais réussi à copier ce modèle ?
L.S. : Je ne l’ai jamais su. Il faut d’abord dire que l’ingénierie de Renault était hostile à ce projet mais en même temps, je suis persuadé que personne d’autre qu’elle n’aurait su faire. Il y a chez Renault une volonté du défi, une acceptation de sortir des sentiers battus qui, je pense, n’existe pas ailleurs. Car au fond, on sait depuis 2005 que Dacia fait un tabac et que ce sont les meilleures marges de Renault. Et normalement, il faut quatre à cinq ans pour concevoir une voiture. Quatre ans après la sortie du Scenic, tous les concurrents avaient un modèle similaire. Dacia n’a jamais eu de concurrents. Je pense qu’il fallait à la fois le vouloir et une ingénierie qui ait envie de relever un défi plutôt que de faire toujours plus ou toujours mieux. Je dis souvent que ce n’est pas parce que nos voitures sont plus belles que nos clients sont plus riches. Dans l’automobile, le schéma classique était, que lors du remplacement d’une voiture, vous en fassiez une plus belle, plus équipée, plus lourde. Et à ma connaissance, Dacia était le seul cas où l’on a dérogé à ce "toujours plus". Tant que l’écart avec les autres est suffisant, tout va bien. À un moment donné, il faudra peut‑être redémarrer avec une voiture encore moins chère.
J.A. : Est‑ce vital aujourd’hui pour Renault d’avoir des partenaires ?
L.S. : Le partenariat le plus important est celui avec les fournisseurs. Car c’est un partenariat gagnant‑gagnant. Avec un concurrent, c’est toujours difficile. Il y a eu quelques expériences avec PSA, avec GM, avec Mercedes, avec VW… Le risque est que le partage du gâteau l’emporte toujours sur sa fabrication. Renault, il y a un ou deux ans, était dans une situation financière très difficile. Maintenant, le cash est revenu. La pression pour trouver des partenaires n’est plus la même. Quand nous avons fait l’Alliance avec Nissan, ce n’était pas parce que nous manquions de volume, mais je me disais qu’entrer sur les marchés américain et asiatique était un investissement hors de prix. L’Alliance avec Nissan était beaucoup moins chère que d’entrer seul sur ces marchés. Aujourd’hui, il y a de nouveaux marchés (Afrique, Asie), mais avec l’avantage compétitif de la famille Dacia, nous n’avons pas le même problème. En revanche, nous avons raté la Chine et c’est un de mes regrets.
J.A. : Chaque année, la polémique sur le salaire de Carlos Tavares se fait plus grande. Ce sujet existait‑il lors de votre présidence ?
L.S. : Nos salaires étaient beaucoup plus modestes à l’époque ! Il y a eu d’abord un bruit sur le salaire de Carlos Ghosn. Et on pensait que le fait de rendre les salaires publics allait les faire baisser. Et cela a eu l’effet inverse.
A lire aussi : Le salaire de Carlos Tavares dans le collimateur de certains investisseurs
J.A. : Vous avez eu beaucoup de vies : politique, industrielle, associative… Quelle est celle que vous avez préférée ?
L.S. : Je n’ai pas vraiment eu de vie politique, car la politique, c’est se faire élire et une élection à un conseil d’administration n’a rien à voir avec une élection populaire. Dans le fond, je n’ai jamais cessé d’être heureux. Être directeur de cabinet a été passionnant. Et c’est sans doute le moment de ma vie où j’ai eu le plus de pouvoirs réels. J’ai adoré cette période. Tout comme ma vie chez Renault. Là, c’était concret et j’étais entièrement responsable de ce que je faisais. Ensuite, j’ai eu la chance en quittant Renault d’être nommé à la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité). J’ai passionnément aimé et j’ai eu le coeur brisé lors de son arrêt. J’ai été très heureux, également, comme commissaire général à l’investissement. Donc, franchement, j’ai eu la chance de vivre des moments très différents et je ne me suis jamais ennuyé. La période la plus intense a sans doute été quand j’étais patron de Renault.
Je suis convaincu que l’éthique et l’efficacité convergent sur le long terme. Si vous traitez les gens à l’américaine, vous finissez comme Boeing. Si vous mentez au client, il vous arrive la même chose qu’à Volkswagen et si vous traitez mal vos fournisseurs, sur le court terme, vous gagnez vite, mais sur le long terme, cela ne marche pas non plus. C’est très important. Nous avons un système d’économie financiarisée. Par la force des choses, le court terme est privilégié par rapport au long terme.
Sur le même sujet

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.