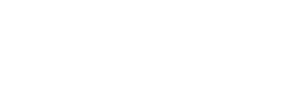Voitures neuves : comment la flambée des prix a fait chuter le marché de 22 %

Depuis 2019, les ventes de véhicules neufs ont chuté de 22 %, passant de 2,2 à 1,7 million d'unités. Pour comprendre dans quelle mesure la hausse des prix a contribué à ce décrochage, le Groupe d’études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile (Gerpisa) s’est penché sur l’évolution du marché ces cinq dernières années. Pour cela, l’institution s’est tournée vers le cabinet d’études C-Ways et l'Institut mobilités en transition de l'Iddri.
Premier constat : depuis 2020, les prix des véhicules ont nettement augmenté, de manière presque linéaire jusqu’en 2023, avant de se stabiliser en 2024, puis de décroître au premier semestre 2025. Pour établir cette évolution, le cabinet C-Ways et l'Iddri se sont basés sur des prix catalogues pondérés par les ventes de véhicules, sans les rabais et remises.
Si un véhicule coûtait en moyenne 28 000 euros en 2020, il faut désormais compter 34 000 euros en 2025. Cela représente une hausse de 6 110 euros sur cinq ans. En 2024, un pic de 6 800 euros avait même été atteint. Comme le souligne Clément Dupont-Roc, directeur stratégie automobile chez C-Ways : "Les difficultés du marché ont entraîné une légère décrue depuis 2024. Néanmoins, cela reste une augmentation non négligeable et nous ne pouvons pas nous empêcher de faire le lien entre la baisse des volumes de plus de 20 % et la hausse des prix de plus de 20 %."
Une éviction progressive des classes populaires
Les travaux de l’Iddri et de C-Ways confirment que le prix influence directement les volumes. La structure du marché par catégorie sociale s’est transformée entre 2019 et 2024. Ainsi, les classes populaires et moyennes (déciles 1 à 6), qui représentaient 43 % du marché en 2019 – soit les personnes gagnant moins de 3 000 euros nets par mois – ne pèsent plus que 30 % du marché. En parallèle, la part des classes moyennes supérieures (déciles 7 et 8) est restée stable, tandis que celle des déciles 9 et 10 est passée de 40 % à 50 % du marché.
"Leur part augmente, mais leur volume reste stable", assure Clément Dupont-Roc. Le nombre de véhicules achetés par ces ménages demeure autour de 570 000 unités. "En fait, la Covid et l’inflation n’ont pas altéré les comportements d’achat des déciles 7 à 10. En revanche, les achats de voitures par les classes populaires et moyennes ont été divisés par deux. En sortant du marché, ce sont ces catégories sociales qui creusent le déficit des ventes de véhicules particuliers", explique le Gerpisa.
Les facteurs qui expliquent l’augmentation des prix
Le Gerpisa identifie quatre facteurs expliquant la hausse des prix entre 2020 et le premier semestre 2025. Le premier est exogène : l’inflation, tant sur les matières premières que sur les salaires. Pour l’institut, ce facteur reste maîtrisé : il représente 6 % de la hausse totale de 22 %, soit moins que l’inflation générale constatée dans l’économie française (10 %).
Vient ensuite l’électrification et la montée en puissance des modèles hybrides et électriques. "Nous qualifions ce facteur d'hybride, car il n’est ni totalement exogène ni endogène. C’est un phénomène poussé à la fois par la réglementation et par les constructeurs, qui font des choix sur les motorisations qu’ils mettent sur la route", observe le directeur stratégie de C-Ways. Là encore, l’effet sur les prix est de l’ordre de 7 %.
Effet segmentation et pricing power
L’équipe en charge de l’étude observe aussi un facteur endogène : l’upmarket, ou effet de segmentation. Le cabinet C-Ways note une baisse du nombre de véhicules dans le segment A et une légère hausse des modèles dans les segments C et B-SUV, au détriment du segment B des berlines. Cet effet de segmentation explique également 7 % de la hausse du prix moyen des voitures.
Une qualification d’"endogène" que les constructeurs n’apprécient pas toujours : "Les marques expliquent qu’elles ont arrêté les véhicules de segment A en raison de leur faible rentabilité, notamment à cause de la réglementation GSR2. Un effet d’offre qu’elles jugent exogène. Mais nous l’avons qualifié d’endogène, car il relève du choix des constructeurs de maintenir ou non ce segment sur le marché", souligne Clément Dupont-Roc.
Enfin, le dernier facteur est le pricing power, également classé parmi les facteurs endogènes. Le cabinet constate qu'il s’est affaibli : il ne représente plus que 2 % de la hausse du prix moyen. "Si nous nous étions arrêtés en 2024, le pricing power aurait représenté 4 % de la hausse", précise Clément Dupont-Roc. En 2025, l’augmentation nette du prix est de 600 euros par rapport à la valeur moyenne catalogue d’un véhicule en 2020.
Des stratégies contrastées selon les constructeurs
En appliquant cette méthodologie à chaque constructeur, le Gerpisa montre que la hausse des prix résulte principalement de choix commerciaux et stratégiques. Six constructeurs sur quatorze ont vu le prix moyen de leurs modèles croître significativement en raison d’une montée en gamme ou de l’électrification.
Mercedes illustre clairement la stratégie de repositionnement. "La marque à l’étoile a assumé son désengagement du segment C, ce qui a entraîné la chute des ventes de Classe A et de CLA afin de devenir une marque de luxe", détaille Clément Dupont-Roc. La part des ventes Mercedes dans le segment C est ainsi passée de 35 % à 20 %, au profit des segments D et E. Le prix moyen a donc augmenté de 44 %, dont 20 % dus à la segmentation.
Même constat pour Ford, qui a "abandonné la Fiesta et la Focus pour se concentrer sur le segment du Puma", selon le directeur stratégie de C-Ways. Kia, Hyundai et Renault ont quant à eux appliqué la stratégie "value over volume" décrite par Luca de Meo, avec une hausse de segmentation impactant respectivement le prix moyen de leurs modèles de 15 %, 8 % et 7 %.
L’électrification pèse aussi lourdement sur les prix. Par exemple, Fiat a vu le prix moyen de ses modèles grimper de 42 %, dont 25 % dus à l’électrification. "La Fiat 500 est passée de 18 000 euros en version thermique à près de 30 000 euros en électrique, impliquant une montée en gamme sans changement de taille ou de segment", pointe Clément Dupont-Roc. Chez Mercedes, l’électrification explique 27 % de la hausse du prix moyen.
Une augmentation des prix injustifiée
Certaines marques ont simplement choisi d’augmenter leurs tarifs, à l’image de Dacia. "Le constructeur, qui partait de prix bas, a relevé ses tarifs tout en conservant les mêmes modèles, car les clients continuent de les acheter malgré tout", détaille Clément Dupont-Roc. Sur les 44 % d’augmentation, 34 % sont dus au pricing power et à l’inflation.
Même constat chez Skoda, dont le prix moyen des modèles a augmenté de 27 %, dont 24 % imputables au pricing, "ce qui n’a pas empêché la marque de gagner des parts de marché", ponctue Clément Dupont-Roc.
Le Gerpisa observe une tendance similaire chez Opel, avec une hausse de 27 % des prix, dont 23 % liée à une augmentation pure et simple des tarifs "afin de se différencier de Citroën, qui doit rester en bas du spectre de Stellantis", précise Clément Dupont-Roc – un repositionnement accompagné d’une forte baisse de volume. Le reste du marché oscille entre 15 % et 20 % d’augmentation, selon des stratégies diverses. À noter : Volkswagen et Peugeot ont été particulièrement impactés par l’inflation.
Comment freiner la hausse des prix ?
L’Iddri et C-Ways formulent plusieurs recommandations pour limiter l’impact des prix sur les immatriculations. Le cabinet reprend d’abord les préconisations du rapport Draghi, qui propose notamment des obligations en matière de contenu local et un soutien financier "massif" à l’industrie des batteries pour lui faire traverser la "vallée de la mort". Cela permettrait de réduire le coût des batteries produites en Europe et de limiter la dépendance aux importations.
Les deux organismes proposent également d’étendre la norme CAFE à l’empreinte des batteries et aux matières premières, afin de soutenir la production européenne. Comme évoqué par la Commission européenne, ils suggèrent aussi la création d’une catégorie de petits véhicules autour de 15 000 euros et la relance du bas de gamme pour "mettre un terme à la spirale inflationniste des prix, enrayer la baisse des volumes, relancer l’industrie européenne et stimuler la demande", selon les conclusions de l’Iddri et C-Ways.
Enfin, ces mesures doivent s’accompagner de "coups de pouce", selon l’Iddri : renforcer les incitations fiscales en les rendant permanentes, instaurer un bonus écologique "conditionné à l’efficacité des véhicules électriques" et un leasing social prenant en compte la taille, le prix et le contenu du véhicule. En parallèle, l’institut préconise aussi de mobiliser les flottes privées et publiques par le biais de quotas écologiques.
Sur le même sujet

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.