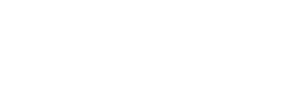La bagnole, j’arrête quand je veux !
...à conduire…
La dépendance à l'égard de l'automobile : "N'est-il pas inutilement provocateur et sommairement idéologique d'associer ainsi l'automobile à une drogue ?", interroge le préfacier de l'ouvrage Gabriel Dupuy, commandité par le Predit et publié par La Documentation Française. Non, à y regarder de plus près tous les ingrédients de la drogue sont bien présents dans l'automobile, une drogue collective et contagieuse. En effet, l'automobile, au départ objet de désir puis source de plaisir et d'évasion, a accru notre tolérance envers l'éloignement des commerces, des services, des lieux de travail, éloignement qui s'est imposé à tous, même aux non-automobilistes. Eux-mêmes, se sont vus contraints de devenir automobilistes, faute d'une concurrence suffisante des autres moyens de transports. "D'inextricables cercles vicieux renforcent puissamment ces tendances, comme le phénomène de la maman-taxi : à cause du danger provoqué par la circulation automobile, les parents sont obligés d'amener leurs enfants à leurs activités… en voiture. Ainsi, alors que dans les années 70, seul un quart des déplacements des 5 à 10 ans se faisait en voiture, aujourd'hui, c'est environ 60 %". L'automobile, est ainsi devenue un besoin, une dépendance, et même une condition sine qua non à l'intégration sociale.
C'est grave, docteur ?
Les enjeux sociaux, urbanistiques, énergétiques et environnementaux imposent une réduction de cette dépendance automobile. Différentes politiques ont été menées :
FOCUSLes prochaines parutions Le Predit, Programme de recherche et d'innovation dans les transports terrestres, vise à favoriser l'émergence de systèmes de transport économiquement et socialement plus efficaces. Créé en 1990, il bénéficie d'environ 300 millions d'euros de fonds publics tous les 4 ans. Il finance des recherches et des expérimentations qui peuvent faire l'objet de publications : fin 2006, sur l'exposition à la pollution atmosphérique et au bruit et, en 2007, sur les véhicules propres, l'assistance à la conduite et les systèmes électroniques embarqués. Pour plus d'informations, consulter le site www.predit.prd.fr |
•La régulation par la congestion, sur le principe que trop de trafic automobile tue le trafic automobile. "Les autorités londoniennes appliquent depuis plusieurs années une telle politique avec un certain succès… Mais elle trouve ses limites dans le fait que, pour éviter la congestion, les activités urbaines, les résidences, la circulation et le stationnement se reportent dans des zones moins denses", la dépendance n'est donc pas réduite, elle est déplacée.
• La réglementation, interdire purement et simplement l'utilisation de son véhicule. "Il s'avère que les mesures prises dans les villes grecques ou italiennes ne sont pas appliquées ou sont détournées".
• La tarification, rendre l'utilisation du véhicule si coûteuse que les autres modes de transport sont préférés même s'ils sont moins rapides. L'exemple du péage de Londres est connu. Son coût de fonctionnement est élevé et son efficacité reste à démontrer. Un autre exemple : "Limiter le stationnement dans les centres villes en fixant des prix très élevés, paraît relativement efficace". Toutefois, il s'avère que "ces politiques de tarification ont des effets inégalitaires et potentiellement ségrégatifs", les plus pauvres étant proportionnellement plus touchés par ses mesures que les plus riches.
La hausse du prix du pétrole ne va-t-elle pas jouer ce rôle de régulation ? Sans effet à court terme, "un renchérissement de 10 % du prix des carburants à long terme entraînerait une réduction de 7 % de la consommation, dont 1 % dû à un resserrement du parc automobile et 2 % dus à une diminution du kilométrage, le reste correspondant au passage à des véhicules plus sobres".
Xavier Champagne
EXTRAITSLes Français moins dépendants mais assignés territorialement En Chine, malgré les efforts constants des constructeurs du monde entier et la volonté gouvernementale d'industrialiser le pays, le système automobile n'est pas encore parvenu à décoller. Il y a un "système cycliste" hyperdéveloppé qui fonctionne si bien qu'il inhibe la croissance du système automobile (NDLR : le taux de motorisation est de 22 véhicules pour 1 000 habitants, contre 120 pour 1 000 au niveau mondial). Aux Etats-Unis, au contraire, le système automobile s'est hypertrophié, la dépendance automobile est maximale et l'on ne fait rien (ou du moins on ne faisait rien jusqu'à une date récente) pour la réduire. En France, tous les ingrédients sont réunis pour une évolution à l'américaine mais l'offre de transports collectifs reste suffisante pour limiter la dépendance. Le déclin des transports publics est en effet moins net qu'au Royaume-Uni grâce aux importantes subventions qu'ils reçoivent. |
Voir aussi :
Sur le même sujet

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.