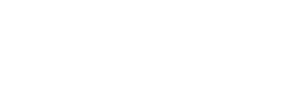Entretien avec Patrick Le Quement, directeur du design industriel chez Renault : "Le succès ne se mesure vraiment qu'en fin de vie d'un modèle"

...En notre compagnie, il revient sur ces modèles, mais aussi sur l'évolution de son métier et sur les détails de l'Alliance. Avec le langage direct et le sens inné de l'image qu'on lui connaît.
Le Journal de l'Automobile : Après deux lancements capitaux pour la marque, Mégane et Scénic, quelle analyse faites-vous de l'accueil réservé par le public à vos modèles ?
Patrick le Quément : Ces deux modèles étaient effectivement très importants, car ils correspondent à des segments sur lesquels Renault possède des parts de marché significatives. En outre, les 1res générations de ces modèles avaient connu un immense succès. A l'heure actuelle, on peut dire que les premiers résultats de la Mégane II et du Scénic II sont bons et parfaitement en ligne avec nos objectifs. Pour Mégane, la 5 portes et la 3 portes connaissent d'excellents débuts, tandis que le break, encore poussif dans l'hexagone, marche très bien sur "ses" marchés, comme l'Italie par exemple. La tri-corps connaît aussi un bon départ, meilleur que la tri-corps de Mégane 1 qui était un sac à dos et n'avait pas été dessinée dès le début du projet. Par ailleurs, avec Mégane, nous avons réussi à rajeunir notre clientèle, ce qui constitue un point stratégique déterminant. Pour la grosse artillerie, c'est-à-dire le Scénic, c'est très bien parti, ce qui est d'autant plus remarquable que nous ne sommes plus du tout isolés sur ce segment ! Cependant, il convient de rester prudent et modeste, car mon expérience m'a appris que le succès ne se mesure vraiment qu'en fin de vie d'un modèle.
J.A. : Sans faire de polémique, ne pensez-vous pas
que l'échec plus ou moins relatif de l'Avantime et de la VelSatis était un passage obligé pour imposer la nouvelle identité Renault et, in fine, ne pensez-vous pas avoir gagné votre pari en réussissant sur les modèles de grande série ?
P. l. Q. : Cette question ne porte pas à polémique et ne doit pas être évitée. Avec cette expérience, on apprend qu'il faut savoir mener une chose à la fois et qu'on peut bousculer les habitudes, mais avec mesure. Le cas de l'Avantime est à part, car il soulève aussi des questions industrielles et commerciales. Trop d'éléments négatifs se sont agrégés sur ce véhicule pour qu'il ait du succès...même si les propriétaires d'Avantime sont fiers du style de leur voiture. Pour la VelSatis, le plan de références était très complexe et la voiture avait été dessinée de l'intérieur vers l'extérieur avec des proportions en rupture. C'était un véhicule vraiment architecturé. En revanche, avec la Mégane, le plan de références correspond aux codes communs et nous avons respecté certains fondamentaux, comme le respect de proportions classiques, l'équilibre du porte-à-faux latéral ou le traitement des dévers donnant l'impression d'une voiture basse à fort caractère. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il faut être conservateur. Au final, ces expériences me font penser à cette phrase de Georges Santayama : "Ceux qui ne se rappellent pas du passé sont condamnés à le répéter".
J.A. : Votre travail sur l'identification de la marque, par le biais de quatre motifs notamment (calandre, logo, ouvrants et de façon plus ponctuelle le décrochage arrière), semble aujourd'hui abouti. Reste maintenant à gagner le pari de l'adhésion durable à la marque : comment comptez-vous vous y prendre ?
P. l. Q. : C'est la troisième phase de notre projet design, mais il convient de faire un retour en arrière pour bien comprendre mes propos. Il y a quinze ans, Renault innovait déjà, mais sous un angle architectural et à un rythme espacé dans le temps. Nous nous sommes donc attelés à innover en permanence et à diffuser cette image auprès du grand public. Durant cette première phase, nous ne savions pas encore qu'il y aurait une troisième phase ! Puis de 1994 à 2001, seconde phase, nous avons travaillé dur l'identification, avec les quatre motifs que vous évoquez. Dans cette optique, les concept-cars ont eu une importance considérable. Désormais, en accord avec la direction générale du groupe naturellement, nous voulons introduire "la vision des trois +" qui se résume ainsi : "séduire plus de monde, plus vite, pour gagner plus d'argent". Cette vision constitue notre réponse à l'enjeu de l'adhésion durable et contient implicitement l'épanouissement de la signature esthétique de la marque avec charme, pour les petits modèles, et sensualité dès que l'on monte en gamme.
J.A. : On retrouve désormais les traits identificateurs de vos VP sur vos VU : en quoi est-ce important et en quoi le traitement stylistique d'un VU est-il différent de celui d'un VP ?
P. l. Q. : Pour un modèle VU, le principe roi est limpide : si on conçoit un style en contradiction avec sa fonctionnalité, on se trompe ! Nos VU, comme le Trafic par exemple, ont du chien, mais ils
FOCUSDesign à deux roues Outre une gamme élargie de scooters et le Groomy, un scooter utilitaire, Renault avait profité du Mondial du deux roues pour dévoiler le Ublo, un concept-bike à... 3 roues ! Le cahier des charges du Ublo a été défini par Renault Sport Design, puis le projet a été initié au centre de design satellite de la marque de Barcelone, avant d'être finalisé au Technocentre. Signe intéressant : le Ublo reprend fidèlement le code d'identification des véhicules Renault à 4 roues. |
J.A. : Rentrons dans vos véhicules désormais : si le concept de "touch design" règne avec bonheur dans
vos concept-cars, on le retrouve avec beaucoup plus
de parcimonie dans vos modèles de série. Pourquoi les applications de série sont-elles aussi progressives ?
P. l. Q. : Renault est un constructeur généraliste qui commercialise des véhicules de grande série. L'enjeu de la rentabilité est donc essentiel, surtout en Europe, le marché le plus difficile du globe ! Nous comptons généraliser les applications du "touch design" sur tous nos modèles, mais cela prendra du temps, car le partage des composants entre gammes et modèles doit être économiquement rationnel. Toutefois, le travail de fond et notre volonté ne sont aucunement remis en cause.
J.A. : D'un point de vue plus structurel, le système des plates-formes tend à transformer la notion de modèle en gamme de modèles : en quoi cette évolution a-t-elle modifié le travail des designers ?
P. l. Q. : Nous avons dû nous adapter sur la forme, c'est-à-dire au niveau des méthodes. En effet, nous sommes passés de la conception d'un duo berline + break à la conception d'une gamme de véhicules pouvant aller jusqu'à 7 variations ! Par ailleurs, une plate-forme est rarement reconduite d'une génération à l'autre et nous devons donc dessiner toute la gamme des véhicules sur la base d'une même plate-forme. Il faut avoir les reins solides pour assumer la conduite de tous ces projets simultanés ! C'est vraiment une énorme évolution. Nous nous retrouvons dans la situation du jongleur à qui on lance des balles supplémentaires au fur et à mesure qu'il fait son numéro. Cela génère aussi beaucoup de stress, car l'amorce des projets devient capitale. L'ADN des premiers véhicules va en effet se retrouver sur tous les autres modèles, donc il doit être bon dès le départ !
J.A. : Un stress d'autant plus important que les délais de conception et développement ont été considérablement raccourcis, n'est-ce pas ?
P. l. Q. : Tout à fait, nous avons de moins en moins de temps pour réaliser nos projets. Chez Renault, nous avons très bien intégré cette donnée et nous comptons parmi les plus rapides du monde, même si pour diverses raisons, les asiatiques restent la référence en la matière. En fait, l'essentiel est de partir de plates-formes qui permettent aux designers de s'exprimer. Dans l'univers des constructeurs, nous avons eu des exemples récents qui prouvent que ce système présente un réel danger de banalisation des modèles ou de positionnement peu pertinent lorsque l'on essaie de chevaucher deux segments. Or, comme la concurrence est plus rude que jadis, le marché ne tolère plus le "passe-partout". La conception initiale des plates-formes doit donc faire l'objet d'un soin particulier. Pour nous, c'est un réel enjeu, surtout au sein de l'Alliance pour assurer le nécessaire distinguo entre Renault et Nissan.
J.A. : A ce propos, que pensez-vous du concept C-Note présenté par Nissan et auquel on reproche une trop grande ressemblance avec la
Mégane au niveau de la face avant ?
P. l. Q. : En fait, si vous regardez le C-Note, vous constaterez que les proportions de sa face avant sont typiques du segment M1, c'est-à-dire du segment de la Mégane certes, mais aussi de la Golf ou de l'Astra par exemple. Par ailleurs, l'identité visuelle de Nissan, et il faut préciser que c'était dans la corbeille de mariage dès le départ, était initialement assez similaire à la notre, comme en témoignent les motifs récurrents de la calandre ou du logo central par exemple. Certaines ressemblances entre nos modèles sont donc naturelles, mais je puis vous assurer que la différenciation entre les deux marques va aller en augmentant.
J.A. : Justement, comment évoluent l'organisation et les actions du Joint Design Policy Group ?
P. l. Q. : Sa 10e réunion a récemment eu lieu et nous rédigeons actuellement un rapport compilant tout ce que nous avons entrepris ensemble. Ce sera une excellente base de réflexion et de travail. Par ailleurs, nous continuons à travailler autour de trois axes : "Différenciation et stratégie design", un volet qui implique que chaque marque a le droit de voir ce que fait l'autre, "Ressources Humaines Design" qui assure un échange permanent entre les équipes et des ponts de carrières entre les deux marques, et enfin, le "Code des meilleures pratiques Design". Nous apprenons beaucoup les uns des autres et cela nous a permis d'évoluer significativement. De plus, très honnêtement, je pense que ces échanges se font de manière équitable.
J.A. : Sous un angle plus prospectif, on dit communément aujourd'hui que la voiture de 2020 sera une voiture à l'hydrogène. Au niveau de la date, cela ne tient-il pas du fantasme et quelle est, selon vous, la voiture de demain ?
P. l. Q. : Tout d'abord, je crois qu'il faut du fantasme, car cela est porteur de sens et d'idéal. C'est effectivement une voie d'avenir, mais il y en a d'autres. Certaines recherches de miniaturisation aboutiront prochainement et ouvriront de vastes perspectives au niveau de l'espace et du gain de masse. Les produits seront aussi de plus en plus compacts et habitables. Par ailleurs, nous devons tous nous rapprocher de la notion du "environmental friendly". Enfin, le véhicule de demain s'inscrit dans une réflexion générale sur la mobilité, qui englobe notamment la problématique urbaine des transports en commun.
J.A. : Pour conclure sur une note personnelle, pouvez-vous nous dire quels sont les produits qui vous ont récemment ému ou séduit, tous secteurs du design industriel confondus ?
P. l. Q. : A brûle-pourpoint, je citerai le i-pod d'Apple, un produit génial et très "touch design" dont on comprend à l'instinct le mode de fonctionnement ! C'est l'apothéose de la démarche de Steve Jobs. Par ailleurs, comme je suis fasciné par les univers du mobilier et de l'éclairage, qui produisent des objets magiques et relativement abordables, je peux évoquer la lampe Miss K réalisée par Philippe Starck pour Flos. Très séduisante, elle permet de faire évoluer l'atmosphère d'une pièce grâce à un travail subtil sur les diffuseurs.
Propos recueillis par Alexandre Guillet
CURRICULUM VITAE1966 : Sa carrière débute chez Simca où il côtoie John Pinko, un dessinateur d'exception qui le marquera fortement. Peu convaincus par la politique de la marque, comme la piteuse 1100 par exemple, les deux hommes décident alors de fonder leur propre agence. Mais Style International ne survivra pas à la crise de 1968. Fin 1968 : Patrick le Quément rentre chez Ford où il occupera diverses fonctions aux quatre coins du globe (Allemagne, Angleterre, Australie, Brésil, Japon, USA...). En 1981, il devient directeur du Design Ford et travaille notamment avec les célèbres Bob Lutz et Uwe Bahnsen. A 36 ans, c'est le plus jeune directeur du Design de l'histoire du groupe ! 1985 : Il intègre ensuite Volkswagen-Audi, la référence de l'époque en matière de design. Il crée et dirige le Centre de Design Avancé et Stratégie, avant de devenir directeur du Design du groupe. 1987 : Renault fait appel à ses services. Il a postulé onze fois en douze ans chez le constructeur au losange et sa décision est donc immédiate. On connaît la suite ! Réorganisation totale de l'unité Design de la marque, lancement de modèles "historiques", travail en commun avec des jeunes prometteurs comme Jean-Pierre Ploué ou Anne Asensio, saga des concept-cars... Et ce n'est pas fini ! |
Sur le même sujet

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.