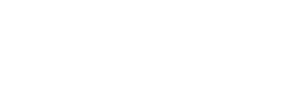"2 millions de VE en circulation correspondent à seulement 1 % de notre consommation annuelle d’énergie !"

Journal de l’Automobile. Quels étaient les enjeux principaux pour l’Avere dans l’organisation de cette 1re édition des Trophées des villes électromobiles ?
Charlotte de Silguy. Ils sont de nature différente, mais au premier chef, il s’agissait de mettre à l’honneur les collectivités territoriales. Avec les entreprises, c’est l’une de nos cibles prioritaires et nous cherchons à les accompagner dans leur réflexion sur la mobilité durable en général, et la mobilité électrique en particulier. Par ailleurs, ces Trophées doivent nous permettre de renforcer notre notoriété, notamment via les médias, au service du véhicule électrique.
JA. Pour une première, tirez-vous un bilan satisfaisant de la participation des collectivités à ces nouveaux prix ?
CDS. Nous sommes satisfaits car nous avons reçu une quarantaine de dossiers, je parle exclusivement des dossiers pertinents et bien renseignés. Rapporté à l’état de germination du chantier du VE, c’est assurément une réussite. Notre partenariat avec l’AMF nous a permis de contacter les quelque mille collectivités de plus de 10 000 habitants. A l’issue de mailings, nous avons ensuite réalisé un travail important de phoning. Je crois qu’il est aussi important de souligner que de nombreuses collectivités, engagées dans un processus intéressant sur la mobilité, n’ont pas voulu présenter leur candidature cette année car elles estiment que le travail est en cours et que les résultats seront plus éloquents dans quelques années. Lors des éditions à venir, nous aurons plus de dossiers et des projets plus matures et opérationnels.
JA. Quelles sont les dominantes ou les particularités des dossiers ayant fait l’objet d’une présélection cette année ?
CDS. La bonne surprise, qui correspond d’ailleurs à une préconisation de l’Ademe, a été de constater que la plupart avaient initié une réflexion globale sur la mobilité et/ou, mais souvent et, sur l’empreinte environnementale des transports. Tous les lauréats partagent cette qualité. Par ailleurs, on peut relever deux projets-phares se distinguant dans les dossiers. D’une part, la mise en place de systèmes de partage de véhicules, quelle que soit leur taille. Ces initiatives sont souvent prises par les villes ou des structures privées et visent à compléter les services des transports en commun. On perçoit ici un mouvement de fond qui vient questionner le principe de propriété automobile. La notion d’achat et de consommation de mobilité tend d’ailleurs à devenir de plus en plus manifeste chez les plus jeunes, on le voit dans leurs arbitrages budgétaires. D’un point de vue plus général, cela renvoie au fameux glissement de l’ère industrielle à celle de l’information et des services. D’autre part, les systèmes de livraison sur les derniers km se développent fortement. On voit émerger des organisations de dispatch de marchandises par quartier, voire par rue. L’utilité des vélos, 3 roues et des fourgonnettes électriques est alors avérée.
JA. Cela se traduit-il mécaniquement par des projets d’acquisition de véhicules électriques au sens large ?
CDS. Tout à fait. Soulignons que dans ce contexte, le véhicule électrique inclut bien entendu les 2 roues, scooters, vélos etc..., qui ont le vent en poupe. Les VUL électriques sont aussi largement mis en avant. Et même si ce ne sont pas les mêmes acteurs ni les mêmes échelles d’investissement, il faut aussi faire le lien avec les transports en commun électriques, comme les bus ou les tramways par exemple. L’ensemble visant à rationaliser la mobilité des collectivités et à participer à l’effort environnemental, local et global. On dépasse largement l’électoralisme et le green-washing. C’est désormais une véritable prise de conscience par rapport aux conséquences de la pollution. Or, même si nous n’avons pas de données très précises sur le sujet, chacun sait pertinemment que l’impact de la pollution sur la santé est très significatif et que cela a un coût humain comme économique.
JA. Vu la multiplication des Salons, des colloques et des initiatives sur le VE, avec des jeux de concurrence que l’on devine en filigrane, cela n’a-t-il pas été trop difficile de fédérer autour de vos Trophées ?
CDS. Comme toujours, quand quelque chose de nouveau apparaît, ça foisonne. Mais il ne faut pas voir que le mauvais côté des choses et je dirais que nous sommes précisément enchantés que ça foisonne à ce point ! Bien sûr, il y a de l’opportunisme, bien sûr, il y a du green-washing. Mais ensuite, il nous revient de ne pas perdre notre clairvoyance et de rester professionnels dans nos choix. De toutes les façons, l’Avere n’a pas vocation à entrer dans un jeu de concurrence, notre rôle étant de sensibiliser les dirigeants politiques, les collectivités et les entreprises au VE. Bref, ce foisonnement va dans le sens de la promotion du VE et de la mobilité durable et il s’agit donc de capter la dimension positive de ce dynamisme. Or nous avons plus que jamais la conviction que le VE répond à une très large part des usages.
JA. A propos des usages, feriez-vous une distinction marquée entre zones urbaines et zones rurales, postulat communément admis alors qu’il peut être remis en cause ?
CDS. Précisément, nous sommes convaincus que le VE n’est pas spécifiquement urbain ! Il peut même être très spécifiquement rural ! En effet, sous l’angle des infrastructures de charge, qui seront bientôt déployées dans les villes, on constate qu’il y a en France 15 millions de pavillons dans les zones rurales, donc autant de possibilités de charge sans délai. Par ailleurs, les réseaux de transports en commun ne sont pas souvent très bien maillés dans ces zones. Enfin, ce n’est pas parce qu’on habite à la campagne qu’on fait systématiquement plus de 100 km par jour ! Un trajet de l’ordre de moins de 80 km par jour correspond en réalité à 9/10e des usages. Pour des besoins occasionnels, on sait qu’il existe d’autres solutions, plus intéressantes tant écologiquement qu’économiquement. Nous estimons, avec d’autres d’ailleurs, qu’il est aujourd’hui important de casser ce mythe du VE strictement urbain.
JA. On oppose aussi souvent au VE son prix très élevé. Diriez-vous aussi qu’il s’agit d’un mythe ?
CDS. Ce n’est pas tout à fait la même chose. En toute neutralité, on sait que l’amortissement du coût d’un VE pourrait se faire en deux ans. C’est là que les courbes de rentabilité se croisent. Ce n’est donc pas si long que cela, surtout rapporté à un loyer mensuel. Le problème réside dans le fait que certains acteurs ont communiqué sur le prix facial, sans le mettre en perspective. Alors qu’il convient de communiquer sur un coût d’utilisation, mensuel ou quotidien mais toujours tout compris, ce qui va d’ailleurs dans le sens du nouveau paradigme de services de mobilité que nous évoquions précédemment. C’est un argument d’autant plus important vis-à-vis des flottes, qui ont déjà majoritairement externalisé leur flotte et raisonnent déjà en termes de loyer. Le rôle des grands loueurs sera déterminant pour accélérer les choses.
JA. Justement, à quel terme voyez-vous les choses accélérer ?
CDS. Je pense que d’ici quatre ou cinq ans, la situation se décantera. Nous aurons alors plus de preuves sur le coût d’usage réel des VE et sur leurs valeurs résiduelles. Dès lors, avec le traditionnel effet d’échelle de l’industrie qui se répercutera sur les coûts, je pense que nous assisterons au même phénomène qu’avec les ordinateurs ou les téléphones mobiles. D’ailleurs, au-delà des opérateurs de mobilité, on voit d’ores et déjà poindre l’idée d’agrégateurs de mobilité qui couvrent l’ensemble des paramètres de la mobilité électrique. Sur tous les acteurs qui se positionnent, start-up comme grands groupes, il n’y aura pas que des gagnants, surtout que des choix différents sont pris. Mais dans le lot, il y a les futurs Facebook ou Google de la mobilité.
JA. Vous évoquiez tout à l’heure vos rapports avec la sphère politique : y rencontrez-vous un écho plus fort qu’auparavant ?
CDS. Oui, bien sûr. Par exemple, quand nous alertons sur la pertinence d’une certaine catégorie de véhicules, en l’occurrence les quadricycles, au-delà de certaines zones urbaines, nous rencontrons des gens à l’écoute. D’une manière générale, l’écoute est forte aussi car l’industrie automobile française traverse une passe dif-ficile. Or on connaît son poids économique et surtout social, par le biais de l’emploi.
JA. En revanche, peu de partis politiques en font un cheval de bataille et on peut même dire qu’à faire le choix de l’autophobie, les Verts ont peut-être un peu raté le coche, n’est-ce pas ?
CDS. On peut comprendre que les écologistes soient mal à l’aise sur le sujet, même sur le véhicule électrique. En effet, on parle d’électricité nucléaire… Pourtant, si on se fie à certains calculs officiels qui n’ont rien de fantaisiste, on constate que 2 millions de VE en circulation correspondent à 1 % de notre consommation annuelle d’énergie ! Ce n’est pas grand-chose… Surtout si on compare cette donnée à celle de la consommation de tous les équipements de type consoles, télés, ordinateurs, par exemple. Là, c’est 12 %… Qui parle de cela d’ailleurs ? Est-ce que les écologistes disent aux Français qu’il ne faut pas acheter de télé ou d’ordinateur ? Bref, il faut rester lucides et mettre les choses en perspective. Le VE n’est pas si énergivore que cela et son développement n’implique pas du tout de construire de nouvelles centrales. Attention, je ne dis pas que le VE est la panacée et qu’il va tout remplacer, mais je suis convaincue qu’entre ses avantages et ses inconvénients, il en a aussi, il répond à bien des besoins. D’un point de vue sociétal, en outre, le VE permet comme d’autres orientations de remettre l’humain au centre de la problématique.
JA. Que répondez-vous à ceux qui objectent que le VE n’est adapté qu’à la France et aux quelques pays ayant une forte production nucléaire ?
CDS. C’est schématique, mais surtout dommage, dans la mesure où cela réduit la problématique environnementale au CO2. C’est dangereux ! On ne peut pas occulter tous les problèmes environnementaux liés aux transports et à la civilisation du pétrole. Et face aux défis environnementaux, dans la lignée des travaux de Nicolas Stern, on sait que le coût de la non-action des gouvernements est supérieur aux coûts de l’action. Même d’un strict point de vue économique, il faut aujourd’hui réagir et essayer de nouvelles solutions. A bien des égards, il est temps de regagner de l’indépendance par rapport au pétrole. D’autant que l’effet boomerang sera violent… Mais comme c’est un poison à petit feu, cela laisse la possibilité à certains de minimiser l’urgence de la situation. Bref, il ne faut pas voir l’environnement et les transports que par la lorgnette du CO2. Dès lors, le VE est une véritable opportunité. D’autant plus à saisir qu’elle est concomitante d’un changement de paradigme de la mobilité et d’une mutation de l’ère industrielle à une ère des services.
Sur le même sujet

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.