Dossier IA – Luc Julia, Renault Group : "Les meilleurs ingénieurs IA dans la Silicon Valley sont français"

Le Journal de l’Automobile : On parle beaucoup d’intelligence artificielle (IA)… Mais de quoi parle‑t‑on exactement et faut‑il en avoir peur ?
Luc Julia : C’est une bonne question parce que l’IA existe en réalité depuis des milliers d’années. L’homme a inventé des machines qui étaient capables de faire des choses à sa place. Au XVIIe siècle, Pascal avait conçu la première machine à calculer. C’était de l’intelligence artificielle. Si on revient à l’IA au sens de l’époque contemporaine, on peut dire que le premier protocole a été établi en 1958 lorsque des scientifiques ont construit un modèle statistique, mais très vite, on entre dans l’hiver de l’IA. L’IA évolue au fil des années et puis arrive Internet et l’IA entre dans une autre dimension avec les data. Et là, on dispose de beaucoup, beaucoup, beaucoup de données et les modèles d’IA statistique reprennent des couleurs.
C’est à ce moment‑là que le nom d’intelligence artificielle apparaît. Pour la petite histoire, le premier protocole d’analyse de ces données, c’est un reconnaisseur de chats, parce qu’on s’aperçoit qu’on trouve quantité de photos de chats sur Internet. On lui a donné 100 000 photos de chats et il a ensuite été capable de reconnaître des chats à 98 %. C’est extraordinaire mais un humain n’a pas besoin de 100 000 photos de chats pour être en capacité d’en reconnaître un. Alors, on s’aperçoit que notre système d’IA doit apprendre, c’est le deep learning. Tout va très vite car les ordinateurs sont toujours plus puissants.
En 2016, lorsque pour la première fois, un ordinateur bat un Sud‑Coréen dans un jeu de go, il a fallu mobiliser jusqu’à 4 000 W de puissance en semi‑conducteurs. Le joueur humain en face dispose au maximum d’un équivalent de 20 W. Sauf que cet humain est capable de faire plein d’autres choses avec ses 20 W : cuisiner, jouer aux dames… Pour que notre ordinateur de 4 000 W joue aux dames, il faut tout recommencer depuis le début. Je pense donc qu’on peut tous s’arrêter deux secondes, respirer un grand coup avant de s’alarmer sur tout ce que j’entends autour de l’IA qui va nous remplacer.

ChatGPT représente environ 1 200 milliards de paramètres. ©AdobeStock-metamorworks
J.A. : L’IA générative va plus loin que jouer aux dames…
L. J. : L’IA générative, c’est juste la dernière évolution en date de l’IA statistique telle qu’on la connaît depuis un certain temps maintenant et qui profite simplement de l’immense progrès de notre capacité de calcul des données pour atteindre des sommets qu’on pourrait qualifier de déraisonnables. À titre d’exemple, ChatGPT, c’est environ 1 200 milliards de paramètres. On est à des années‑lumière des 100 000 photos de chats. Imaginez l’énergie nécessaire pour calculer tout ça. Ce n’est pas soutenable. Il faudra donc trouver des modèles plus spécialisés à l’avenir.
J.A. : L’IA, est‑ce fiable ?
L. J. : Pour que l’IA reconnaisse les chats, il fallait lui montrer des chats. Ainsi, l’IA répète ce qu’on lui a appris et comme Internet est truffé de fake news, il y a donc un sujet autour de la pertinence de l’IA. Une expérimentation a été menée par des universitaires sur des questions simples posées à l’IA. On s’est aperçu que seulement 64 % de ses réponses étaient vraies. Imaginez que 36 % des réponses de votre collaborateur soient fausses ? Vous ne le qualifieriez certainement pas de fiable et vous le changeriez.
J.A. : Faut‑il réguler l’IA ?
L. J. : Évidemment ! Parce que l’IA, c’est un outil et comme tous les outils, il peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. Donc, oui, il faut réguler… Mais certainement pas à la manière de l’Europe. Vous connaissez la plaisanterie ? "Aux États‑Unis, on invente. En Chine, on copie. En Europe, on régule." Le problème, c’est que l’Europe ne régule pas, elle interdit. Elle interdit des technologies au lieu d’interdire certains champs de leur application. Exemple : les caméras de reconnaissance faciale. C’est une formidable invention, utile pour un tas de cas d’usage. Mais en Chine, ils s’en servent pour le social scoring. En Europe, plutôt que d’interdire le social scoring, on interdit la caméra à reconnaissance faciale. Et pour faire bouger la moindre ligne dans les textes au niveau des institutions européennes, cela prend dix ans… En face, aux États‑Unis, la régulation, c’est simple, il n’y en a pas.
J.A. : L’Europe est‑elle donc à la traîne ?
L. J. : Il faut faire très attention quand on dit ça, parce qu’en réalité, en Europe, et plus particulièrement en France, nous sommes les meilleurs du monde en matière d’IA. Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les médailles Fields (le prix Nobel des mathématiques, NDLR). Et je peux vous confirmer que depuis 30 ans, tous les chefs de l’IA dans la Silicon Valley sont français. Nous sommes reconnus comme des dieux de l’IA là‑bas, mais pas ici. Cherchez l’erreur. Depuis 2013, cela va mieux, avec Fleur Pellerin, ou la start‑up nation qu’on moque beaucoup. Un nouvel esprit entrepreneurial anime la France et des choses incroyables émergent. Les jeunes ne partent plus aux États‑Unis à 18 ans, comme moi, parce qu’on est bien plus capable d’accueillir leurs idées.
J.A. : Quel est le problème en France ?
L. J. : C’est le venture capital. Les start‑up arrivent à se financer en France parce que les pouvoirs publics donnent une impulsion. C’est plutôt dans la phase scale‑up qu’il n’y a plus personne, alors que c’est à ce moment‑là qu’elles ont besoin d’argent pour se développer. La culture de l’échec n’existe pas en Europe. Ici, nous stigmatisons l’échec. Aux États‑Unis, on le valorise comme un apprentissage. Un investisseur aura donc plus de réticences à investir dans une start‑up en France qu’aux États‑Unis par peur de l’échec.
J.A. : Est‑ce que l’IA est une question de vie ou de mort pour un constructeur automobile ?
L. J. : Ce qui est certain, c’est qu’un constructeur qui n’investit pas cette technologie a de bonnes chances de devenir obsolète. Alors, comme je réfutais l’idée que l’IA était une révolution, mais plutôt une évolution mathématique, à l’inverse, il faut bien voir qu’on a une révolution des usages. Et si je ne rentre pas dans cette révolution, je passe à côté de quelque chose. Mais le vrai sujet, c’est d’abord comprendre à quoi servent ces outils et ce qu’ils peuvent nous apporter.
Beaucoup de métiers ont pensé qu’ils seraient remplacés. Il a fallu leur montrer qu’en réalité, l’IA les aiderait à être meilleurs. Les designers, par exemple, vont pouvoir être encore plus créatifs grâce à de nouveaux outils IA. L’IA ne remplacera pas l’humain. Si nous, nous ne le faisons pas, c’est le concurrent en face qui le fera et sera plus efficace que nous. On n’ira pas forcément plus vite, mais on fera mieux. Et ça, ça change tout.
L’autre sujet, c’est d’identifier tous les cas d’usage. Et dans l’automobile, vous avez des tas de métiers différents, dont certains que je ne connaissais pas. Soit autant de cas d’usage dans lesquels l’IA a un rôle à jouer. On a identifié une centaine de cas dans les fonctions de support, le design, les ventes, le marketing, etc. Ce n’est pas terminé, il y a certainement des milliers de cas d’usage, mais c’est déjà un bon début car l’objectif, c’est aussi de peaufiner la maturité de cette technologie et notre propre maturité face à elle. Chez Renault, nous avons 105 000 salariés… L’enjeu de formation est immense mais nécessaire parce qu’il nous permet d’affiner notre connaissance des cas d’usage.
J.A. : Certains de vos concurrents ont créé d’énormes structures dédiées à cette technologie…
L. J. : C’est une grosse erreur. Dans mon service, nous sommes 7 ingénieurs purement IA… Demain, on sera peut‑être 20. Pas 4 000 comme ailleurs, 20 ! Ensuite, il y a environ 300 personnes qui travaillent sur de la data science. L’idée c’est que dans chaque service, une personne ait une approche IA. C’est comme ça que nous pouvons identifier les cas d’usage directement dans l’opérationnel de terrain. Il n’est donc pas utile d’avoir une armée d’ingénieurs IA, mais de bien cartographier les besoins et les individus et trouver les bonnes solutions opérationnelles.
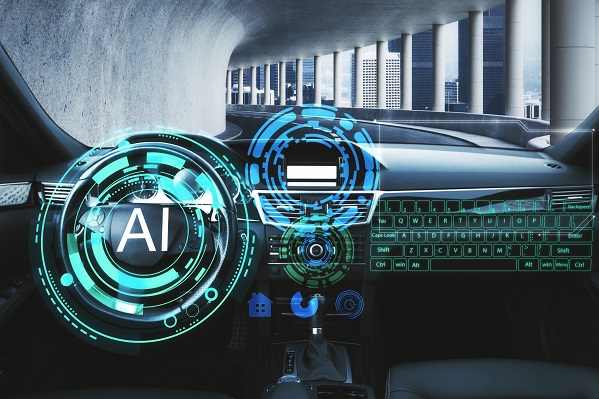
Un constructeur qui n’investit pas dans l'IA aujourd'hui a de bonnes chances de devenir obsolète. ©AdobeStock-Who is Danny
J.A. : N’est‑ce pas plus efficace de s’appuyer sur un écosystème de start‑up plutôt que tout internaliser en partant d’une feuille blanche ?
L. J. : La start‑up chez Renault, c’est moi. Alors, bien sûr, on va chercher des trucs ailleurs. Mais Renault avait besoin que j’apporte une culture de la start‑up pour ne plus avoir peur d’y avoir recours. Parce que le problème d’une start‑up, c’est qu’elle peut mourir du jour au lendemain. Cela fait courir un risque opérationnel pour nous. On a appris à gérer ça.
J.A. : À quel horizon va‑t‑on voir des produits qui comportent de l’IA ?
L. J. : Là, maintenant. On a déjà mis en place des outils et nous sommes en train de les déployer. Vous verrez que nous pourrons concevoir des voitures plus rapidement grâce à eux.
J.A. : Est‑ce que le SDV (software defined vehicle) est l’aboutissement ultime de ce que peut offrir l’IA ?
L. J. : Oui, alors le SDV, c’est pour occuper les médias. Oui, le SDV, c’est intéressant, on va pouvoir créer des modules, ajouter des fonctionnalités. Ce sera moins de hardware, plus de software. Avant, nous avions des dizaines d’ordinateurs dans une voiture, demain nous en aurons trois. Nous pourrons faire des choses que nous ne pouvions pas faire avant. Donc, oui, le SDV est une architecture intéressante et sera incontournable pour un constructeur automobile. Mais l’IA recouvre bien plus de champs que cela : les fonctions de support, le marketing… Les gains pour l’entreprise y sont tout aussi importants. Et je connais des constructeurs qui ont construit des architectures SDV avec 40 ingénieurs.
J.A. : L’IA représente‑t‑elle un lourd investissement ?
L. J. : Cela dépend. Établir un protocole IA dans la distribution par exemple, ça ne coûtera pas cher. Ce qui coûtera cher, c’est son déploiement. Après, oui, concevoir une application IA nécessite de la ressource et du temps de développement. Ce n’est pas gratuit. Il faut mettre cela en perspective avec les gains.
J.A. : Faut‑il établir des standards pour fluidifier le marché ?
L. J. : Les standards, ça n’existe pas. Même sur des choses simplissimes comme les prises électriques. Vous allez en Angleterre ou aux États‑Unis, il faut une prise différente, l’ampérage n’est pas le même… Dans les technologies, c’est pareil. À chaque fois qu’on tente d’établir des standards, il y a toujours une entreprise qui veut implémenter sa propre techno pour se distinguer ou simplement par ego.
J.A. : Les Gafam n’ont‑ils pas déjà une longueur d’avance sur les constructeurs ?
L. J. : Il y a des cycles même chez les Gamam, parce que Facebook, ça s’appelle Meta maintenant. Regardez Google. Ils ont commencé leurs travaux sur les voitures il y a douze ans. Ils ne vendent toujours pas de voitures. Ils ont retravaillé leur méthode en créant Waymo, justement pour des problématiques de taille. Meta, Amazon, Apple… ils tentent de rattraper leur retard. Microsoft a eu le nez suffisamment fin pour investir dans OpenAI au moment de sa création, ils en bénéficient donc aujourd’hui. Mais concrètement, Waymo, qui est probablement le plus avancé, perd de l’argent, ils viennent d’ailleurs de lever cinq milliards de dollars, et fait tourner quelques centaines de voitures entre San Francisco et Phoenix, avec un prix deux fois plus cher qu’un Uber.
J.A. : Oui mais les constructeurs automobiles, européens notamment, n’en sont pas là…
L. J. : Oui, mais ils vont rattraper. Je vous rappelle que nous avons les meilleurs ingénieurs. Et la bonne nouvelle, c’est que Google a déjà essuyé pas mal de plâtres, ça va nous éviter de passer 12 ans à les rattraper. Il faudra juste revoir les règles de régulation européennes pour nous donner les moyens d’y arriver. Parce qu’au final, il n’y aura de la place que pour trois acteurs.
Sur le même sujet

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.






