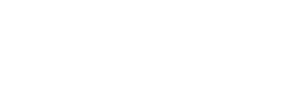Journée de la Femme, une vision
Epicène : se dit d’un nom (masculin ou féminin) qui désigne aussi bien le mâle que la femelle d’une espèce (l’aigle, la loutre), nous apprend le Robert culturel. La forme de ce nom ne varie pas avec le genre : homme ou femme, chacun peut être fragile ; homme ou femme, on peut être ministre ; qu’il soit fille ou garçon, il reste un enfant.
Il paraît opportun de souligner ce phénomène de la langue française, en ce mois de mars qui célèbre rituellement "la journée de la femme". "Épicène" est un terme lourd de sens sur la place qu’on donne et veut donner à celle-ci dans la société. Mais plus précisément encore dans l’emploi.
Favoriser l’emploi des femmes est devenu un enjeu de société et de RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise). Pour le promouvoir et acter que les femmes ont des compétences égales à celles des hommes, on les oriente vers des métiers dits "traditionnellement masculins", qu’elles investissent avec un réel succès. L’autre grand enjeu demeure le partage des fonctions de pouvoir et de responsabilité au plus haut niveau des entreprises et des autorités publiques.
Jusque-là, tout va bien. Mais ne s’arrête-t-on pas au milieu du gué ?
La paternité attentive
Si on s’en tient aux mots, on cherche avant tout à féminiser les emplois masculins, au risque d’arriver à certaines dérives, quand il s’agit de les nommer : tôlier/tôlière, professeur/professeure…
Il n’est en revanche pas anodin de constater qu’on néglige de masculiniser les métiers féminins, par exemple, "sage-homme", et que ces messieurs éprouvent une motivation modérée à se diriger vers ces créneaux. Est-ce à dire que le sens et le genre du progrès est forcément masculin ?
Le meilleur moyen de prouver qu’il n’en est rien serait de décloisonner les cases, pas seulement au travail, mais dans la société tout entière, jusque dans la maison. Et d’adopter une "épicène attitude" qui ne s’arrête pas au partage des tâches domestiques. Elle s’étend à l’ensemble du partage entre les activités professionnelles et les activités familiales. Ce partage, on le voit de plus en plus, ne repose plus sur une différenciation de genre comme naguère (monsieur au bureau, madame aux fourneaux), mais souvent sur l’exercice en commun d’une responsabilité partagée : celle de parent, responsabilité elle aussi épicène.
Rentrer plus tôt le soir au lieu de s’attarder à des réunions professionnelles dont l’efficacité décroît avec l’heure, ceci pour aider son enfant à faire ses devoirs, l’emmener, sur son temps de travail, chez le médecin quand il en a besoin, sont des attitudes sociales désormais acceptées, mais, il faut le constater, un peu moins pour les hommes que pour les femmes…
L’"épicène attitude" déculpabilise la femme au regard de ses engagements professionnels en lui rappelant qu’au XXIe siècle, sa mission ne se réduit plus à la procréation et à l’éducation. Elle pose le principe que la création lui est ouverte, dans toutes ses dimensions. Et que la réussite professionnelle est une oeuvre à part entière. Cette "épicène attitude" déculpabilise aussi l’homme en étendant son champ de responsabilités dans un cadre qui ne le limite plus à celui du travail. Lui aussi a des engagements propres qui ont de la valeur dans un espace qui n’est pas l’espace professionnel mais celui de la famille.
La liberté, le progrès en la matière n’ont pas de genre, et sont des valeurs épicènes qui profitent à chacun et à chacune.
Par Philippe Caïla, directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
Sur le même sujet

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.