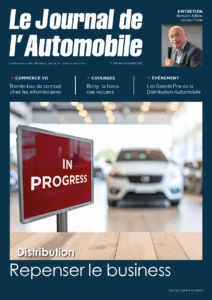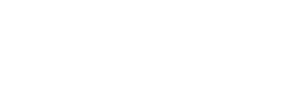La mobilité automobile au ralenti

A-t-on atteint un pic en termes de mobilité automobile ? C’est la question que se pose l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) d’Ile-de-France dans une note du mois d’avril. D’après son analyse, la baisse de la mobilité automobile est constante ces dix dernières années dans la région. L’IAU de s’interroger si cette tendance va se pérenniser, aux profits de modes de déplacement alternatifs. L’institut, en plus de l’aspect social et générationnel qui redessine la mobilité, décèle un contraste important entre le centre urbain et sa périphérie.
Entre 2001 et 2010, l’IAU constate en effet que "la mobilité automobile individuelle voiture, c’est-à-dire le nombre moyen de déplacements réalisés en voiture par un Francilien un jour de semaine, a diminué, passant de 1,54 à 1,46. En revanche, en grande couronne, non seulement la mobilité voiture ne baisse pas, mais elle continue de croître à un rythme sensiblement identique à celui des périodes précédentes". L’institut isole quatre facteurs permettant d’expliquer le ralentissement de la mobilité automobile.
Question générationnelle
D’abord, ce que l’IAU appelle les tendances anciennes, qui s’achèvent ou sont en passe de le faire. En effet, à l’inverse des décennies précédentes, la mobilité des femmes s’est stabilisée. "Aujourd’hui, les femmes se déplacent toujours un peu moins en voiture que les hommes, mais l’écart a fondu : les hommes effectuent 1,6 déplacement quotidien en voiture, les femmes à peine moins de 1,4. Cette évolution à la hausse est étroitement corrélée à celle du taux d’activité des femmes, qui a littéralement explosé entre 1968 et 2008, passant de 54% à 79% et se rapprochant de celui des hommes (87%)", détaille l’IAU.
A cela s’ajoute la mobilité des retraités, qui a continué de croître dans le contexte de baisse générale. "Aujourd’hui, les retraités ont plus souvent le permis que les autres Franciliens. Leurs ménages sont plus équipés en voitures et leur mobilité automobile a rejoint la moyenne de la population", ce qui amène l’IAU à penser que la situation va se stabiliser dans les prochaines décennies. "Puissant moteur depuis quarante ans de la croissance de l’usage automobile, la mobilité des retraités n’y contribuera désormais probablement plus que marginalement", présage-t-il.
Troisième facteur : la réticence des jeunes. Qualifiée de changement récent dont l’évolution reste incertaine, cette tendance concerne tous les moins de 30 ans, étant particulièrement sensible chez les 18-25 ans. "En 1983, près de 60% d’entre eux possédaient le permis. En 2010, cette proportion est tombée à 44%", précise l’étude. La question économique est au cœur du problème, avec, "pour commencer, le coût du permis lui-même, le coût d’une voiture ensuite, puis celui de son entretien et du carburant, qui pèsent lourd dans le budget d’un étudiant ou d’un jeune actif. En comparaison, les transports en commun sont plus accessibles".
L’étude tempère cependant ce phénomène, assurant que "l’automobile n’a pas perdu son utilité, notamment dans certains territoires dépourvus d’alternative ou encore à certaines étapes du cycle de vie, comme l’arrivée d’enfants dans le ménage. Il est donc très probable que cette baisse de la possession du permis de conduire chez les plus jeunes ne soit que l’effet d’une forme de temporisation reportant à plus tard le moment de le passer".
La 4e raison de la baisse de la mobilité en Ile-de-France serait une conséquence de la saturation du réseau routier. "L’Ile-de-France détient les records européens de trafic avec plus de 240000 véhicules par jour en moyenne en 2010 sur cinq de ces tronçons : trois tronçons du boulevard périphérique, un tronçon de l’A1 et de l’A4", rappelle l’IAU (voir encadré). Dans ce contexte, nombre de Franciliens ont préféré délaisser leur véhicule. "La forte progression de l’utilisation des transports en commun observée, 0,78 déplacement par personne et par jour contre 0,68 entre 2001 et 2010, s’est donc produite dans un contexte très important de saturation du réseau routier", assure l’institut.
Phénomène généralisé
Si l’IAU s’est penché uniquement sur l’Ile-de-France, il semble que la tendance soit générale aux pays développés. Et la possession autant que le kilométrage parcouru sont concernés. A l’automne 2012 d’ailleurs, The Economist se faisait l’écho de plusieurs études allant dans ce sens. Selon un premier document émis par le gouvernement australien, "20 pays développés, dont la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, montrent une tendance à la saturation du kilométrage parcouru en véhicule. Après des décennies où chacun, en moyenne, voyageait davantage chaque année, la croissance par personne a ralenti de manière distincte et, dans plusieurs cas, a stoppé complètement".
Le phénomène de saturation est constaté autant sur le kilométrage total que sur la distance parcourue par automobiliste, ou encore sur le nombre de trajets effectués. La hausse des prix des carburants est bien évidemment incriminée, exacerbée par la récession qui touche les économies développées. L’hebdomadaire note cependant une autre tendance : s’appuyant sur une enquête de l’Université du Michigan reposant sur 15 pays, il révèle que le taux de possession du permis de conduire est en dessous de la normale dans les régions où les jeunes utilisent beaucoup Internet. La voiture y est un simple appareil, davantage qu’une chose à laquelle on aspire. Selon TNS, dans une étude sur les habitudes des adolescents, "les médias sociaux leur donnent accès à un monde auquel on accédait, auparavant, à l’aide d’un véhicule".
Selon l’IAU, "l’émergence de ce phénomène de baisse de la mobilité automobile remet en cause ce qui structurait les politiques de déplacements depuis très longtemps : l’usage de la voiture". Dans l’Enquête globale transport, réalisée par le Stif (Syndicat des transports d’Ile-de-France) auprès de 18000 ménages, on rappelle cependant que "si la croissance des déplacements en transports collectifs concerne tous les Franciliens et tous les départements, la diminution du nombre de déplacements en voiture par personne s’est seulement produite dans la partie la plus dense de l’Ile-de-France, à Paris et dans le cœur des agglomérations".
Si la situation montre qu’il s’agit d’un mouvement général, l’IAU en vient à la conclusion que s’il faut "accompagner les Franciliens dans leur choix de rompre avec les habitudes passées, il faut également tenir compte de la diversité des besoins de mobilité individuels, qui s’expriment de manière très différente selon les territoires et les populations et qui, parfois, ne peuvent écarter l’usage de l’automobile".
-------------
FOCUS - Les routes d’Europe désengorgées
A en croire Inrix, fournisseur de services d’info-trafic, les embouteillages ont diminué en 2012 de 18% à l’échelle européenne et de 12% dans l’Hexagone. Un allégement de la circulation qui se confirme au premier trimestre 2013, et qui serait de mauvais augure pour l’économie du Vieux Continent. En effet, comme l’indique Bryan Mistele, P-dg d’Inrix, "il y a toujours une forte corrélation entre la santé économique et le niveau d’encombrement sur nos axes routiers. Cela nous indique si les citoyens ont un travail et s’y rendent en voiture, sortent au restaurant, et si les entreprises livrent des produits".
Il n’est donc pas étonnant de retrouver le Portugal (-50%) et l’Espagne (-38%) aux deux premières places du classement européen des plus fortes baisses du trafic routier. L’augmentation des taux de chômage, conjuguée à la baisse du pouvoir d’achat, en 2012, sont en effet synonymes de réseaux routiers nettement moins saturés. Avec sa baisse de 12%, la France occupe la 9e place de ce classement. Sans surprise, Paris est la ville française la plus embouteillée avec 63 heures perdues en 2012, malgré une diminution de 9% sur deux ans.
Sur le même sujet

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.