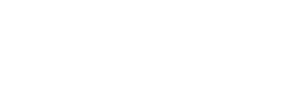Nouvelles perspectives pour le vitrage

...doivent décidément faire preuve d'inventivité.
Les équipementiers vont bien, merci pour eux. Peu nombreux, quelques groupes se partagent l'ensemble du marché. Un marché dont les innovations sont souvent déterminantes dans les appels d'offres des constructeurs. Ainsi, les AGC/Splintex, St-Gobain Sekurit et autres poids lourds comme Pilkington rivalisent de R&D pour proposer des solutions de plus en plus ingénieuses, valorisantes pour leurs clients. C'est ainsi que l'on a vu nombre de nouveautés ces dernières années, certaines devenant même de véritables tendances de fond. Tout a commencé avec l'apparition du verre feuilleté dans les pare-brise, devenu obligatoire au 1er janvier 1983, pour des raisons de sécurité. Auparavant les vitrages répondaient au doux nom de vitrage trempé, en raison d'un traitement leur permettant, lors d'un impact, de se briser en mille morceaux pour éviter les coupures. L'avancée du feuilleté va permettre de gagner en sécurité, par l'ajout d'un intercalaire en polycarbonate entre deux feuilles de verre. Cette sorte de sandwich maintient notamment l'intégrité du pare-brise, même après un impact. Outre la sécurité pure induite par l'utilisation de pare-brise feuilleté, plusieurs autres avantages vont en découler. Ce type de vitrage protège par exemple mieux du vol, puisque même cassé, le pare-brise reste en place et retarde le malfaiteur. Par ailleurs, les équipes d'ingénieurs des équipementiers se prennent à rêver à de nouvelles améliorations du concept…
Plus de confort
C'est ainsi qu'après avoir développé les lunettes arrière chauffantes au moyen d'un réseau de fils métalliques collés à la surface du vitrage, l'attention s'est portée sur un produit équivalent, pour l'avant cette fois, avec la contrainte supplémentaire de ne pas perturber la vision du conducteur. D'où l'idée d'un verre chauffant, avec deux technologies proposées. La première solution utilise des fils chauffants microscopiques incorporés entre les deux feuilles de verre du pare-brise feuilleté. Si les fabricants s'en défendent, cela reste un tantinet visible pour le conducteur. Il est donc également possible d'utiliser, en guise d'intercalaire, une couche conductible appliquée sur la surface totale du verre. Totalement invisible, cette seconde solution semble plus prometteuse pour l'avenir.
Concernant les nuisances sonores, le vitrage acoustique conçu par St-Gobain Sekurit a permis de développer un verre feuilleté avec un intercalaire PVB (polyvinyle butyral) absorbant le bruit, inséré entre les deux feuilles de verre, pour une qualité d'insonorisation supérieure à celle obtenue par un verre feuilleté classique. Le produit réduit significativement les bruits de basse fréquence à l'intérieur d'un véhicule, jusqu'à 6 décibels. Les bruits aérodynamiques sont quant à eux atténués de 10 décibels. Bien sûr, le niveau sonore atteint les plus basses valeurs lorsque toutes les surfaces vitrées (vitres latérales, pare-brise, lunette AR…) sont équipées de verre acoustique. Sans compter l'excellent moyen de dissuasion que constitue l'utilisation de vitres latérales feuilletées pour les voleurs, qui ne peuvent désormais plus pénétrer dans les voitures, ou perdent, selon les chiffres mesurés, environ 10 fois plus de temps… Si les bénéfices semblent donc évidents, les équipementiers regrettent la passivité des revendeurs à mettre en avant les vitrages techniques (voir pages 36/37).
Côté confort thermique, le vitrage a aussi fait un bond considérable. Les pare-brise absorbants ou réfléchissants la chaleur sont constitués de verres aux propriétés thermiques remarquables. Ils réduisent la pénétration de l'énergie solaire à l'intérieur du véhicule, par l'utilisation, là encore, d'un intercalaire spécifique. D'où la protection du conducteur et des passagers des effets néfastes du soleil, la protection des garnitures intérieures contre le vieillissement prématuré… Ajoutez à cela le développement du vitrage hydrophobe, évitant que les gouttes de pluie ne s'étalent sur la surface totale du pare-brise, et vous aurez une idée des trésors d'ingéniosité qu'ont dû déployer les ingénieurs pour développer leurs produits.
Les constructeurs, vecteurs de tendance
Bref, des produits de plus en plus techniques, soutenus par l'imagination débordante des constructeurs. En 1980, la surface vitrée moyenne d'un véhicule était de 3,40 m2. En 2006, elle représentait 4,5 m2 (soit une augmentation de plus de 30 % en 26 ans).
Un habitacle plus lumineux, un meilleur confort de conduite, et des stylistes de plus en plus audacieux ; voici les éléments qui tirent le développement des vitrages pour l'automobile.
Car les designers rivalisent d'ingéniosité pour accroître la surface vitrée à bord des nouveaux modèles, et c'est ainsi que les pare-brise dits panoramiques se généralisent, avec le succès que l'on sait. Sur le C4 Picasso, Citroën en fait même officiellement un argument de vente, inventant le terme de Visiospace. Et la tendance se poursuit jusque dans les toits ouvrants, qui laissent peu à peu leur place à de gigantesques éléments panoramiques, toujours dans un souci de clarté et de liberté pour les passagers. Sur ce marché, ce sont les Français qui ont eu le nez creux. Ils parviennent à vendre, en effet, près de 5 % de leurs véhicules avec un toit panoramique, là où VW et Ford ne décollent pas des 1 à 2 %. Fin de la parenthèse.
L'évolution logique du vitrage va donc vers le pare-brise et le toit panoramique en une seule et même pièce. Mais le processus de développement se révèle très long, en raison des difficultés de production que suscitent de tels produits. Les contraintes de torsion de la structure de la voiture posent également des problèmes de casse sur des éléments de cette taille. Les équipementiers réfléchissent donc aujourd'hui à des solutions composites, plus légères et qui permettent des formes et des courbures toujours plus extravagantes.
Toujours plus loin
Face à la pression des constructeurs, toujours plus demandeurs, à la fois d'innovations, mais aussi d'efforts industriels et commerciaux, les fabricants de vitrage deviennent peu à peu des "systémiers". Ainsi, ils développent de plus en plus de solutions dites modulaires. Il s'agit, dans leur usine, d'intégrer des fonctionnalités aux vitrages purs, afin de faciliter leur utilisation lors de l'assemblage en ligne, chez le constructeur.
Cela prend la forme d'un vitrage complet, livré pratiquement "prêt-à-monter", qui requiert un minimum d'opérations durant la phase d'assemblage sur les véhicules.
Ainsi, chez St-Gobain, on pratique l'extrusion directe d'un profil caoutchouc sur le verre, servant par exemple à la fixation et l'étanchéité d'un toit panoramique. Outre la rentabilité pour le constructeur, une telle technologie améliore sensiblement le style et l'aérodynamique, par la suppression de joint apparent. Pour faciliter les opérations de montage sur ligne, on peut aussi encapsuler un joint autour d'un vitrage, en surmoulant le verre par une matière plastique. Des composants additionnels tels que des vis, embases, connecteurs… servant à des fonctions annexes, peuvent même être ajoutés au vitrage durant la phase d'encapsulation.
A l'avenir
Les surfaces vitrées allant croissantes dans les automobiles modernes, chacun se prend à rêver à de nouvelles fonctionnalités. C'est ainsi, par exemple, que l'on voit apparaître des antennes intégrées pour tout un éventail d'utilisations, de la réception d'un programme radio aux signaux de télévision, en passant, bien sûr, par ceux des systèmes GPS, du téléphone…, pour lesquels il faudrait normalement plusieurs types d'antennes. Les bénéfices sont multiples. On citera pêle-mêle l'agrément visuel, le regroupement des fonctions, la quasi-disparition du risque de vandalisme… Les antennes intégrées dans une vitre présentent enfin d'excellentes qualités de réception, dues aux propriétés diélectriques intrinsèques du verre…
Mais les ingénieurs travaillent aussi sur des vitrages dits "intelligents", toujours sur la base du feuilletage, qui offre décidément un panel illimité de possibilités. En plus de l'intercalaire PVB placé entre les deux couches de verre formant le vitrage définitif, on ajoute par exemple une couche "électrochrome" supplémentaire qui, sous les sollicitations électriques (1,5 V), va foncer ou éclaircir la surface vitrée. St-Gobain équipe déjà une voiture d'exception avec ce procédé. Il s'agit du toit panoramique de la Ferrari Superamerica. En poussant un peu plus le raisonnement, un vitrage électroluminescent a même vu le jour. Cette fois, la couche ajoutée entre les deux strates de verre vise à modifier la transparence de la surface vitrée, et même à donner une ambiance particulière à l'intérieur du véhicule, par un jeu de lumières allumées/éteintes. Enfin, pour les plus férus de hautes technologies, l'application la plus surprenante consiste à intégrer des signaux vidéo dans un pare-brise par exemple. Entendons-nous bien, nous ne parlons pas ici d'une projection sur le vitrage, mais bien d'une image générée entre les deux couches de verre ! Ce qui ouvre la voie à de nombreuses applications telles que la vision tête haute des indications de tableau de bord, mais aussi, pourquoi pas, le visionnage de films pour les passagers, où encore des indications d'alertes routières…
Bref, le secteur du vitrage reste particulièrement dynamique, à la fois chez les équipementiers, qui développent des produits innovants, mais aussi chez les constructeurs, qui comprennent le fantastique potentiel commercial que représente le vitrage. Reste maintenant à expliquer au réseau de vente comment mettre en valeur ces éléments, vecteurs de forte différenciation.
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.