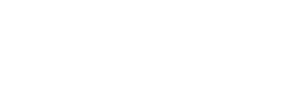Les constructeurs occidentaux face aux tigres asiatiques
...stricte qui pourrait se résumer ainsi : premiers arrivés, premiers servis.
Pas facile dans les années 80 de mesurer précisément l'ampleur qu'allait prendre la croissance chinoise et sa place dans l'économie mondiale. Pas même dans l'industrie automobile. Pourtant, quelques constructeurs étrangers se sont lancés dans l'aventure. Et Volkswagen fait ici figure de pionnier. Dès 1984, l'allemand n'a pas hésité à pénétrer une terre vierge de toute marque automobile étrangère, un territoire où tout restait à faire. A cette époque, les premiers "immigrants" ont bénéficié de toutes les aides gouvernementales et locales disponibles : autorisations administratives, statut fiscal particulier, implantations industrielles intéressantes… C'est ainsi que Volkswagen a pu profiter, par exemple, d'une défiscalisation très avantageuse et d'une réelle politique d'intégration locale. Trois formes d'implantations sont possibles pour les investisseurs étrangers en Chine : le bureau de représentation, le joint-venture avec un partenaire local majoritaire et la société à capitaux exclusivement étrangers. La Chine restant très régulée par les autorités, tant dans ses importations que ses partenariats, un acteur étranger ne peut débarquer sur le territoire sans accord officiel et sans partenaire local. En outre, le lieu d'implantation pour ses futurs sites de production lui est indiqué. Le joint-venture est donc la forme la plus couramment utilisée car elle permet une installation durable pour le nouvel arrivant.
Selon Sébastien Amichi, directeur d'études au sein du cabinet Roland Berger Strategy Consultants, "pour les constructeurs automobiles étrangers, le JV avec un partenaire local est la forme incontournable selon la réglementation chinoise (le catalogue des investissements). C'est aussi l'une des formes les plus complexes, qui nécessite de trouver un partenaire local compatible en termes de portefeuille de produits, de positionnement, de couverture commerciale et de schéma industriel. Le principe est de permettre au partenaire étranger d'accéder au marché local, à condition d'apporter au partenaire chinois un transfert de savoir-faire technologique et industriel."
L'échec du partenariat entre Fiat et Nanjing (le plus ancien constructeur chinois) illustre bien la complexité de tels montages : le portefeuille produit de Fiat n'a pas rencontré le succès attendu en Chine, et Nanjing s'est plutôt concentré sur la reprise de MG Rover et son rapprochement avec SAIC. Résultat : - 30 % de parts de marché pour Fiat et ses modèles Palio, Siena et Perla. "La limite du modèle de JV est dans la capacité à maintenir durablement les intérêts réciproques entre les deux partenaires, tout au long de leur coopération. C'est un équilibre délicat qui peut malheureusement vite basculer vers le conflit comme cela a été le cas pour Dongfeng, Yueda et Kia ou DaimlerChrysler et Beijing Auto. Il y a de nombreuses dimensions qui entrent en jeux : succès des modèles, montage logistique, répartition de fabrication, conditions CKD, intégration locale, conformité des véhicules, prérogatives commerciales, usage de la marque, ré-export, conditions fiscales… Devant ces difficultés, les autorités chinoises devront probablement envisager une nouvelle ère post-JV et introduire de nouveaux modèles d'investissements étrangers dans l'automobile".
Retour en 1985. VW est suivi de près par Peugeot qui s'implante à Guangzhou pour fabriquer la 504 et la 505. Mais la marque française se retire 12 ans plus tard pour diverses raisons : mauvaise implantation industrielle, véhicules apparaissant rapidement obsolètes et peu économiques, concurrence de plus en plus vive, réseau de distribution et de SAV éparses (inférieur à 100 points de ventes), sans oublier les tensions politiques (Tien'anmen en 1989…). Coût estimé de l'opération par les spécialistes du secteur : 3 milliards de dollars. Au cours des 20 dernières années, on s'aperçoit que la conquête chinoise, après celle amorcée dans les années 80, s'est déroulée en deux temps. Vers 1995 tout d'abord avec Audi, Honda et GM, puis en 2004 avec BMW, Toyota et le retour de Peugeot qui s'est appuyé cette fois sur le partenaire de Citroën, Dongfeng. Quant à Renault, l'échec de ses récentes négociations avec les autorités chinoises tend à prouver que le français est arrivé trop tard. Les autorités voulaient en effet placer les sites du constructeur dans des provinces trop éloignées des zones industrielles actives. Renault a donc changé son fusil d'épaule en décidant de s'implanter en Inde. Un pari sur l'avenir pour la marque, une stratégie qui lui permettra peut-être de gagner des points sur cet autre marché low-cost en pleine évolution.
Cas d'école Volkswagen
L'intégration réussie de Volkswagen en Chine est tout à fait représentative du code de bonne conduite à tenir. Le constructeur s'est adjoint le soutien du gouvernement central et des autorités de Shanghai (il s'est même vu décerner le titre de "compagnie privilégiée" en 1993). Il a bénéficié de l'appui politique de l'Allemagne via son Chancelier de l'époque Helmut Kohl. Son programme d'intégration locale fait également intervenir une panoplie de fournisseurs locaux. L'automobile en Chine est devenue un des secteurs les plus importants actuellement (les ventes ont augmenté entre 2002 et 2006 de 22 %, dix fois plus que le marché mondial), et VW est un véritable pourvoyeur d'emplois. Son maillage territorial est équilibré, avec 400 points de ventes et 200 centres de réparation. Enfin, le choix de Shanghai Auto Works et First Auto Works, ses partenaires locaux, lui assurent un potentiel industriel indéniable. Le constructeur vend ainsi 700 000 véhicules par an. Autre succès, celui de General Motors, entré en Chine en 1997. La politique américaine visant à reprendre les relations commerciales avec la Chine, lui a été très favorable. Ses investissements avec son partenaire Jiangling Auto et les JV signés avec SAIC et Wuling, lui ont servi de tremplin. C'est ce qui lui permet actuellement de vendre 850 000 VN par an, dépassant ainsi VW. "Il est remarquable de constater à quel point la stratégie que mène General Motors en Chine est pertinente, plus pertinente que sur son propre territoire durant les dernières années", explique le consultant. Enfin, dans une moindre mesure, Toyota, entré seulement en 2000, a réussi le pari de vendre 160 000 véhicules chaque année. "Le japonais a mis en place une véritable logique de reconstitution d'un groupe automobile chinois via un grand nombre de JV aux différents niveaux de la supply chain (une vingtaine entre assemblage, rang 1 et rang 2). Le groupe a même implanté un centre de R&D en Chine, le Toyota China Technology Center, basé à Tianjin".
Plus d'options mais moins de motorisations
Avec la hausse progressive du pouvoir d'achat de la population, la classe moyenne chinoise s'élève et souhaite assouvir certains besoins. L'achat d'un véhicule en fait naturellement parti. Loin d'être entraînés dans des dépenses compulsives, le client chinois a cependant quelques exigences. Il n'est en effet absolument pas sensible à une marque en particulier mais plutôt au bouche à oreille et aux essais de véhicules. De plus, la promotion d'un modèle ne peut se faire telle qu'en Europe. La publicité n'a en effet que peu d'emprise sur lui. Une marque étrangère doit donc mettre l'accent sur la valorisation de la personne en achetant son modèle, à l'opposé du constructeur chinois qui mise tout sur l'achat efficace. Le consommateur chinois préfère les modèles de moyenne gamme, suréquipés (GPS, toit ouvrant, climatisation…). En revanche, il est nettement moins attaché à tout ce qui relève des performances moteurs et des codes stylistiques. "La concurrence est devenue très intense, en particulier sur le segment principal des modèles à bas coûts, conclut Sébastien Amichi. Mais cela change avec le développement d'une nouvelle classe sociale aisée que certaines marques premium viennent courtiser sur le marché chinois, comme BMW". Le consommateur chinois est en mutation permanente. Ses choix automobiles changeront. Posséder un véhicule est un signe extérieur de richesse, lui conférant un véritable statut social. Pour l'instant, il reste peu sensible aux normes environnementales et peu exigeants quant à la notion de service après-vente, telle que nous la connaissons en Occident. Mais son comportement devrait se modifier. Les constructeurs occidentaux devront donc s'y conformer et s'adapter, d'autant que, selon le consultant, deux tendances se profilent. D'une part, les véhicules coréens et japonais semblent obtenir les faveurs du consommateur depuis deux ans. D'autre part, les constructeurs chinois ont élaboré un programme soutenu de lancement de modèles, favorisé par une politique de préférence nationale, concurrençant directement les importateurs occidentaux.
ZOOM"Les entreprises chinoises n'ont aucun état d'âme" |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.